Français I English I Portugês |
|
|---|---|
|
|
Français I English I Portugês |
|
|---|---|
|
|
+ + +
Exposition collective
Date d'exposition : 02.10.2008 - 17.10.2008
Vernissage : Vendredi 02.10.2008, 18h-22h
Horaires d'ouverture de la galerie :
Lunidi, Mardi et Jeudi de 12h à 18h
Nocturnes les jeudis de 15h à 21h
Lieu :
Galerie Michel Journiac
47, rue des Bergers
75015 Paris
Frances
RER C Javel ou Métro 8 Lourmel
Artistes :
Argentinelee
Nadia Ben Amor
Isabelle Boitel
Isabel Cunha de Almeida
Nikoleta Kerinska
Christelle Mas
Susanne Müler
Chen-Yu Pan
Ghislaine Perchet
Edouard Rolland
Tél. +33 1 44 07 84 40
Texte d'exposition de Léa Bismuth :
La notion de « passage » est complexe, d’autant plus qu’elle est affublée ici d’un énigmatique « s » entre parenthèses, comme si justement on cherchait à ménager un passage entre le singulier et le pluriel, entre l’abstraction de la notion et la multiplicité des sens que l’on peut lui accorder. Ce sont autant de passages entre des pratiques artistiques diverses puisque la photographie, l’installation, la vidéo et la peinture sont convoqués. Ce sont autant de passagers clandestins, qu’ils soient artistes ou spectateurs…
Le passage est un voyage entre des mondes, entre des territoires, entre des pays. Argentinelee, dans son installation vidéo, propose en ce sens de créer une passerelle digitale entre la France et la Corée, Paris et Busan, l’ouest et l’est : elle donne à voir un monde bipolaire où c’est le cosmos qui permet la communication, qui permet au passage d’exister : le « Digicosmos » est la matrice des échanges, la matrice d’un tissu en mouvement perpétuel à l’intérieur duquel les passages migratoires se réalisent.
Il y a aussi des migrations à plus petite échelle, des mouvements au cœur de la ville. Ainsi, Isabelle Boitel, dans ses « Impressions périphériques », met en scène le boulevard périphérique parisien en posant la question géographique du centre et de la périphérie, c’est-à-dire des routes innombrables qui sont censées mener à un noyau hypothétique et fantasmé. S’il y a là le passage entre deux entités distinctes, Isabelle Boitel cherche également à passer de la réalité au rêve : le passage est alors l’évasion d’un régime de réalité à un autre, une fugue vers l’imaginaire et la fiction. L’œuvre abrite le passage d’un monde prosaïque et quotidien (le périphérique) à un monde onirique visuellement pictural en passant d’un medium à un autre, de l’image vidéo à la peinture. Avec Isabelle Boitel, le rêve se glisse dans le passage lui-même.
Plus aérienne, Suzanne Müller s’engage dans une exploration du paysage berlinois vu du métro. Dans ses photographies, un même personnage surgit et s’empare de l’espace de la ville et fixe le spectateur d’un air inquisiteur, le doigt pointé vers lui : ce personnage à l’« étrange regard » est un passager fantôme de ce paysage urbain, il en est aussi l’acteur et le voyeur, il est d’ailleurs sans doute le reflet du spectateur, lui-même passager du métro et passager de l’œuvre. Suzanne Müller n’est pas la seule à créer un personnage, comme si la question du passage invitait à la confusion des mondes, incitait à franchir le mur de la fiction.
En effet, Isabel Da Cunha de Almeida crée le personnage de « Z-héros » dans ses photographies. Chez elle, le passage s’effectue entre le Brésil et la France, la réalité et la fiction, la photographie et la ruse de la représentation : elle construit une réalité fictionnelle en mettant en scène son personnage. Elle détourne l’indicialité photographique au profit de l’imaginaire. De manière similaire, Cheng-Yu Pan donne à voir une Terre virtuelle et satellitaire dans des photographies où d’étranges figures tutélaires et religieuses regardent le spectateur en surplombant le monde.
Avec ces artistes, l’image devient le rhizome d’une représentation critique du monde. Le passage est avant tout détournement et transformation de l’image réalité, un engagement vers les contrées du rêve et de la poésie.
Cette exposition est dominée par la poésie : elle est non seulement hantée par Rimbaud et Verlaine, mais elle propose aussi d’entrer au cœur du dispositif poétique. A ce titre, Christelle Mas travaille à rendre le langage matériel et visuel, en mettant notamment face à face des photographies et des installations. Son travail est une tentative de fusion de la métaphore poétique et de l’objet : en disposant des œufs sur le sol de la galerie, elle invite le spectateur à devenir lui-même poète, à s’adonner à l’association d’idées, à vivre le délitement du langage en matière. Christelle Mas crée une histoire à partir d’éléments formels ; elle donne corps à des poèmes mentaux tout en questionnant notre quotidien le plus intime, la nourriture que nous ingérons tous les jours, entre suspicion et toxicité…
Si le passage est une voie d’accès privilégiée vers le poème, c’est sans doute l’œuvre de Nikoleta Kerinska « Visual Poems 1 » qui le prouve le mieux. En effet, par l’animation numérique et l’image 3D, elle cherche à donner au langage toute sa potentialité visuelle. Le langage devient véritablement un « être vivant », le lieu de passage entre l’œil et l’oreille, la vue et le son, la graphie et le sens. En créant son alphabet du son, Nikoleta Kerinska fait du langage visuel un code à déchiffrer, un code fait d’ondes sonores. Celle-ci offre au spectateur une véritable expérience poétique puisqu’elle lui fait vivre une expérience de correspondance baudelairienne. Dès lors, la synesthésie des sensations propre à l’écriture poétique s’incarne dans le regard du spectateur.
La question du passage appelle intrinsèquement celle du passage de la vie à la mort, celle de l’être passager et éphémère. A cet égard, l’installation de Ghislaine Perichet est particulièrement significative. Chez elle, le passage est conçu de manière négative : le passage est une obstruction et un empêchement. En plaçant le spectateur face à de lourdes portes closes, le passage est littéralement impossible, comme interdit. Pris dans le faisceau lumineux de la projection, les spectateurs deviennent alors des ombres monumentales, condamnées à errer dans un purgatoire imaginaire. Les fantômes règnent alors en maîtres, peut-être parce qu’ils ont la possibilité de traverser les murs, de sortir de leur prison…
Enfin, Edouard Rolland pose aussi la question de la mort dans une installation-sculpture à partir de cinq structures en bois et d’une « empreinte ». Ces éléments appartiennent à un espace incertain entre l’équilibre et la gravité, la verticalité et l’horizontalité, l’élévation et la chute. Ce que cherche Edouard Rolland c’est avant tout à dialectiser l’idée de chute suicidaire : en se détruisant, quelque chose se construit paradoxalement, et c’est dans cette destruction que l’artiste éprouve sa non-maîtrise face à la matière, la puissance de l’accidentel et de l’inattendu. Comme les ombres de Ghislaine Perichet, les planches d’Edouard Rolland sont entre la vie et la mort, dans un étroit passage du temps auquel seul l’art peut accéder.
Ces neuf artistes — par leurs installations, photographies et vidéo — s’emparent de la question du passage non seulement pour l’enrichir, la densifier, mais aussi pour la mettre en procès. Ils ne se contentent jamais de l’anecdote ou de l’illustration, mais décident d’entrer au cœur du concept philosophique du (des) passage(s) avec les moyens de l’art.
Cette exposition montre avant tout que le passage est toujours déjà un chemin de traverse, une prise de risque, un véritable passage à l’acte.
_ Léa Bismuth, Paris, 2009
+ infos
_______________________________________________________________
![]() Archives 2010 I 2009 I 2008
Archives 2010 I 2009 I 2008
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Appareil - Vision
Power
Tower, Paris-Busan réunit 14
artistes français et 12 artistes coréens dans un dialogue plastique
et culturel.
Pour amorcer un échange non seulement entre les individus, mais aussi
entre les formes et les représentations, une ligne directrice leur
a été soumise : la tour.
L’image mentale que suscite une métropole, aussi bien pour le
touriste que pour l’habitant, est généralement dominée
par un monument évident, planté sur la ligne d’horizon.
Paris et Busan ont en commun d’ériger un dispositif technique,
une antenne, qui est par la suite resté comme le signifiant absolu
de la ville.
Comme sujet d’une rencontre entre des artistes issus de deux métropoles,
les grattes-ciels ont ceci de pertinent qu’ils se posent eux-mêmes
comme des formes plastiques en exposition, et en tant que formes ils parlent
un langage qui devrait nous renseigner non pas tant sur les différences
culturelles, mais bien d’avantage sur leur caractère transculturel.
On
pourrait s’imaginer en géants visitant les salles d’exposition
d’une foire mondiale, et apprécier ces architectures sculpturales
les unes après les autres. Yoon-Sek Kim nous propose
une telle inversion des lois de la perspective dans son installation. Pour
être entrés dans le IIIème millénaire, on voit
venir quelques projets audacieux qui rompent avec le formalisme postmoderne
des milliers de projets actuels (London Bridge Tower à Londres, Tour
Phare à la Défense, Liberty Towers à Manhattan...). Avec
le recul historique dont on dispose maintenant, on s’aperçoit
que la stature hiératique des gratte-ciels n’est que toute provisoire,
tant dans leur vitesse d’obsolescence quand il s’agit de prétendre
au record de hauteur que dans leur durée de vie, puisque depuis pas
si longtemps on doit parfois les détruire pour les renouveler.
Pour
ce qui est des constructions de grande hauteur, Paris fait figure d’exception,
puisque la municipalité a établi une frontière invisible
située à 37m au-dessus de la chaussée, en 1975, après
une poussée de fièvre dans le BTP. C’est en soi un indice
sur la volonté de ses institutions de ne pas altérer d’avantage
une certaine image d’elle-même – à l’exception
de grands projets inscrits dans des processus politiques – et préfère
laisser la Défense, un quartier d’affaire distant, à l’expérimentation
des grands groupes financiers. Paris cédera inéluctablement
sous la pression tellurique.
La
plupart des monuments historiques se trouvent relégués au rang
de curiosité locale, quand les gratte-ciels semblent vouloir parler
au monde entier. Le monument incarne un ancrage historique ou culturel,
il ne doit pas être confondu avec le monumental auquel prétendent
les gratte-ciels. Ceux-ci sont d’avantage le produit d’une construction
sociale et économique qui porte aux nues des investisseurs d’ici
ou d’ailleurs, plutôt que des valeurs communes et partagées.
L’échiquier urbain est aussi un échiquier économique,
comme l’évoque Koo-Young Kyoung dans son installation.
Pour ramener à d’autres proportions ce qui n’est qu’une
affaire d’échelle, Baptiste Debombourg expose
un antimonument emblématique et minuscule : à partir d’agitateurs
jetables tels qu’on les trouve auprès des machines à café,
il reconstitue un bistrot bien plus pittoresque. On pense à la répétition
du même et à un geste d’ennui mais aussi à Rem Koolhaas
et sa critique du junkspace, bazar urbain constitué d’unités
architecturale transitoires, jetables, motivées par la raison commerciale.
La théorie du junkspace signe aussi le morcellement de l’espace
public dans sa privatisation hétéroclite. Pas étonnant
alors que coincé dans une cafeteria entre deux étages identiques
d’une tour, on repense avec nostalgie au café du coin...
Quant à Ji-hee Hwang, elle s’emploie à
trouver des lettres dans l’enchevêtrement des formes, qui ensemble
constituent des phrases cachées dans le paysage.
Le
développement urbain et la croissance économique se cristallisent
indéniablement dans la poussée verticale, le phénomène
est mondial. On a coutume de dire que la santé d’une ville se
mesure à la quantité de grues à l’œuvre. Eun-Ho
LEE ne garde que la force érectile pure de ce rapprochement,
qui fait que les gratte-ciels appartiennent à la même représentation
verticale que l’idéal économique de croissance perpétuelle. Gang-Jo Seo n’oublie pas de nous rappeler la propension
naturelle à l’élévation et fait de cette quête
un chemin vers le Paradis céleste, la tour prenant la forme d’un
simple escalier.
Quant
à Maggy Cluseau, elle substitue à la tour la
forme d’une échelle, mais molle, invalidant toute possibilité
d’ascension.
Min-Jung Kim, quant à elle, s’intéresse
au fait, trop souvent vérifié, que ces architectures puissent
se fonder sur une économie de l’exploitation et de la destruction.
Elle empale des mains, qui pourraient être celles des ouvriers, pour
atteindre la hauteur qui sied au respect. Rappelons un fait en passant : le
World Trade Center incarnait la concentration des pouvoirs économiques
et financiers qui font tourner l’économie mondiale, et la catastrophe
humaine du 11 septembre s’est elle-même avérée représenter
un bénéfice net pour l’économie de marché.
La
postmodernité ne serait-elle donc que la synergie de phénomènes
archaïques et du développement technologique ? Avec Une petite
histoire de l’urbanisme, le collectif Bad Beuys Entertainment restitue frénétiquement l’évolution de l’habitat
humain. Par accumulation d’images collectées grâce aux
moteurs de recherche sur Internet, ils déplient non seulement une historiographie
factuelle mais aussi le voisinage improbable des logiques auxquelles appartiennent
leurs modèles architecturaux, où Otis, Bouygues, Georges Lucas
et Mohammed Atta, entre autres, rejoignent les grandes figures de l’architecture.
Les civilisations ont toujours rivalisé pour la hauteur et, puisque
ce n’est plus pour se préserver des prédateurs, les motivations
psychologiques propres à la construction verticale pourraient appartenir
à une mystique simple. « L’architecture est une sorte
d’oratoire de la puissance au moyen de formes », comme écrivait
Nietzsche à l’aube de la révolution industrielle (Le
Crépuscule des Idoles, 1886). Les premiers gratte-ciels de Chicago
datent de 1885. Le journaliste Jean Le Fère, parmi les premiers à
rapporter le phénomène américain en France, se fait plus
pragmatique : « les maisons hautes ont pour but d’étendre
la superficie consacrée aux affaires sans accroître les distances » (Le Petit Journal, 1905). Une autre interprétation propose
même « au sommet des affaires on ne sauvegarde son temps et
sa personne qu’en se tenant méthodiquement assez haut et assez
loin. » (1954, de Gaulle, Charles).
On l’avait compris. La raison logique, pour ne pas dire idéologique,
à la prise d’altitude fait de l’architecture le modèle
physique d’une construction sociale verticale méthodique.
La tour est donc la formalisation d’un principe isolationniste, aujourd’hui
doublé d’ascenseurs qui ne s’arrêtent qu’à
l’étage auquel vous êtes autorisés à accéder.
Le
modèle de la tour s’apparente évidemment à une
succession de plans horizontaux dédiés : transports en sous-sol,
commerces au rez-de-chaussée, éventuellement un restaurant panoramique
au sommet, car comme dit un proverbe coréen, « une vue splendide
n’a aucun charme si la table est dégarnie ». Le reste,
c'est-à-dire l’essentiel de sa surface, n’est qu’une
succession de bureaux d’affaire.
La tour est par nécessité l’expression d’une pensée
fonctionnaliste et normalisante, qui empile le même autant que nécessaire
à amortir ses investissements, sur des parcelles urbaines toujours
plus chères.
Avec HLMHTML Simon Boudvin l’interprète
au plus simple, en répétant les étages de tours d’habitation,
et nous rappelle qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’un
copier-coller, non pas d’une forme architecturale mais de lignes de
code.
Iris Gallarotti s’attache également à
la répétition du même motif, une chambre d’hôtel
standard, sans omettre le style kitsch. La monotonie de sa série de
photos de la chambre ne peut être rompue que par l’adjonction
d’un lien subjectif, en l’état un fil de couture qui courre
à travers les clichés, pour contredire la nature impersonnelle
du lieu. La question en soi de la standardisation nous met au défi
: représente-t-elle un nivellement des différences – de
goût, de mode de vie, d’auto-représentation – ou
la possibilité offerte à la majorité d’accéder
à un même standing ?
«
L’architecture est un geste. Tout mouvement intentionnel du corps
humain n’est pas un geste. Pas plus que tout bâtiment construit
dans une intention donnée n’est de l’architecture. » Wittgenstein, qui a vu à New York les premiers gratte-ciels,
fonde le passage historique et stylistique vers la modernité, notamment
en architecture. Amateur des préceptes d’Adolf Loos, pour qui
il s’agissait d’exclure toute ornementation, d’assujettir
les formes aux fonctions qu’elles doivent servir et, par-dessus tout,
à la pensée qu’elles sont supposées incarner. Architectonique,
distribution spatiale, lumière, minimalisme président à
ces constructions, au point que ce non-style est devenu en quelques décennies
l’archétype de la construction.
D’un
autre côté, on peut constater les efforts certains de nombreux
projets architecturaux monumentaux pour se doter d’une signification
supplémentaire, stylistique ou culturelle, parfois jusqu’à
la caricature. Mi-Yeon Yu revient à cet égard
sur le monument de l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) édifié
en 2005 à Busan pour accueillir ce sommet international, dans une architecture
appuyée sur le symbole traditionnel de la ville : le camélia.
Miyeon Yu ajoute à cette symbolique formelle une référence
supplémentaire, avec un extrait de La Dame aux Camélias d’Alexandre
Dumas fils, où Marguerite, prostituée notoire, suscite les commentaires
de ses contemporains, faisant dévier les intentions consensuelles initiales.
Dans un même esprit syncrétique, qui n’est pas sans alerter
sur l’étendue possible des absurdités architecturales
postmodernes, Kyu-Sik Choi va jusqu’à fusionner
la tour Eiffel et celle de Busan, mais sa sculpture, faite de débris
de verre, pourrait bien s’avérer dangereuse…
Mais
dans une époque qui se donne pour nouveau paradigme l’horizontalité
des réseaux et la multipolarité, le modèle de la tour
a-t-il encore sa place ? Nous convoquons Nicolas Schöffer,
artiste et théoricien français (1912-1992), seul artiste historique
et seul architecte dans cet échange artistique. Il n’a vraisemblablement
pas vécu dans la bonne époque et s’avère d’avantage
indispensable aujourd’hui. Non seulement ses sculptures possédaient
dès 1956 des capacités de communication portées par l’implémentation
de techniques électromécaniques, mais encore son langage plastique
et sa pensée esthétique étaient transposables en architecture.
Son projet de Tour Lumière Cybernétique, conçu
pour le quartier d’affaire de la Défense, proposait une tour
de 360m de haut, dont les panneaux rotatifs et les projecteurs de lumière
embarqués devaient produire des signaux intelligibles pour le public
parisien et le renseigner sur différents aspects de l’état
du monde. Une architecture vive et mobile, une architecture de communication
dialogique plutôt que de domination. 1961, l’année où
s’achevait la construction du premier « gratte-ciel » parisien,
la tour CrouleBarbe, haute de 57m pour 23 étages.
«
La thèse du primat du temps est l'une des formes rhétoriques
dont s'habille l'intimidation par la modernité. Quand on y cède,
on risque de passer à côté d'un événement
clef de la pensée contemporaine, dont on discute sous l'intitulé
de "retour de l'espace". Michel Foucault le dit : Notre époque
sera peut-être surtout une époque de l'espace… »
Peter Sloterdjik, Sphères III, 1998.
Dans sa « sphérologie », Sloterdjik définit neuf
topos non pas solides mais fondés sur ce qu’il y a autour de
l’humain : « un lieu, dans les conditions en vigueur, c'est
un quantum d'air aménagé et conditionné, un local d'atmosphère
transmise et actualisée, un nœud de relations hébergées,
un carrefour dans un réseau de flux de données, une adresse
pour initiatives d'entrepreneurs, une niche pour les relations à soi-même,
un camp de base pour des expéditions dans l'environnement du travail
et de l'expérience, un site pour les affaires commerciales, une zone
de régénération, un garant de la nuit subjective ». Selon lui, notre nouvelle biosphère serait plus proche de
la station spatiale que des tours que l’on connaît, mais renvoie
inexorablement à la même entreprise : quitter la Terre.
Autre philosophe de la ville contemporaine, Fredric Jameson résume
ainsi la situation : « le postmodernisme est ce que l’on a
lorsque le processus de modernisation est achevé et que la nature s’en
est allée pour de bon. » (Postmodernism, or The Cultural
Logic of Late Capitalism, 1991). Cette entreprise de séparation
pourrait aussi se résoudre par le bas, en s’enterrant, comme
le suggère Baptiste Debombourg, dans un grand dessin
aux allures de projet architectural. Rada Boukova va elle
aussi sonder les profondeurs terrestres, dans un geste hérité
de ses propres jeux d’enfant. Elle jette de petits cailloux dans un
cylindre en métal qui émerge du sol. Profond de plusieurs dizaines
de mètres, le tube renvoie l’écho cristallin de la chute
vertigineuse des cailloux. Rappelons un paradoxe : les sous-sols terrestres
et le fond des océans ne sont pas mieux connus que les premières
années-lumière qui nous entourent.
Les
réseaux nous font entrer dans une dimension post-historique, celle
du temps réel de la communication qui abolit la notion même d’espace
à franchir. Pierre Guy et Bruno Botella nous proposent le point de vue d’Howard Hughes, l’ex-aventurier
américain – lorsque après avoir connu le monde entier,
il ne quittait plus sa propre chambre – ce qui n’est pas sans
évoquer un devenir ultrasédentaire possible, quand aujourd’hui
le monde entier peut entrer chez soi, ou qu’on peut le piloter à
distance. Argentinelee et Sébastien Szczyrk poussent le parallèle entre le système urbain et l’architecture
informatique, nous plaçant face à l’évidence de
cette nouvelle infrastructure technique de l’espace, sa réalité
organique qui croît derrière les cloisons : nerfs, veines, appareils
respiratoire et digestif… Le bâtiment technologique impose ses
propres contraintes et un fonctionnement autonome. Il veille même sur
nous.
La tour représente une forme emblématique des nouveaux habitats humains. Quand l’homme semble promis à un devenir toujours plus urbain, l’architecture devient consubstantielle de toute activité humaine, non plus seulement comme environnement ou réceptacle, mais comme condition même de sa réalisation. Le lieu que l’on habite est prépondérant, et cherche dans ses planifications actuelles les synthèses nécessaires à la cohabitation du travail, des loisirs, du commerce, du foyer, etc. Mais est-ce à dire qu’à terme, on ne pourra plus en sortir ? Emmanuelle Mason explore une variété de façons d’habiter corporellement un volume rationnel, cubique, à la fois foyer et cellule, et citation directe du Modulor de Le Corbusier, principe de reformulation des proportions du corps appliqué à l’architecture.
Les différentes perspectives proposées par les artistes de Power
Tower forment le spectre des interrogations et des critiques suscitées
par cette question de la superstructure et du devenir de l’habitat.
Quant à des monuments aussi évidents que la tour Eiffel ou celle
de Busan, la seule façon d’éviter le cliché, c’est
encore d’y grimper. L’expédition au sommet s’avère
même utile pour approcher la réalité dont est faite la
ville, et permet au contemplatif d’en apprécier l’organisation
spatiale, sociale, émotionnelle, dans une perspective quasi isométrique. Mia Kim s’arrête au dernier étage de la
tour, pour regarder le monde en bas, tel qu’il est. Lionel Sabatté détaille quant à lui toutes les anecdotes simultanées
qu’il contient. Ses nombreuses toiles, de tout petits formats, apparaissent
comme autant de boîtes contenant chacune une histoire fébrile
et presque indéchiffrable, voisines les unes des autres mais pourtant
sans relation, hormis peut-être le téléscopage.
Depuis la tour Eiffel on peut voir que le Paris compact hérité du baron Haussmannn est en fait troué de jardins insoupçonnés ; de la tour de Busan on voit les faubourgs populaires accolés à la montagne Youngdusan, seuls vestiges de la ville, avant sa modernisation perpétuelle... Le promeneur exerce ainsi son point de vue en se mettant à distance, dans une position héritée du romantisme, comme le résume Sung-Hyung Lee dans sa sculpture. Le regard de l’homme distant accuse sa séparation du reste du monde, parachevant son individuation mais aussi sa solitude… Mais reconnaissons que là-haut, il n’y a finalement pas d’autre chose à faire que de contempler le monde en bas.
Mathieu Marguerin, le 11 juillet 2007

La Place de l’art dans la ville
Conférence de Mathieu Marguerin à Soul Art Space, le 14 juillet 2007.
Avec l’exposition Power Tower, des artistes de Corée
et de France regardent la ville, dans ses tendances urbanistiques, architecturales,
sociétales.
La question de l’architecture devient prépondérante sur
nos vies et, en Asie, la prochaine Expo Universelle (Shangai 2010) se saisira
aussi de cette question, avec un titre « Better City, Better Life »,
qui laisse supposer que l’agrégation sociale urbaine n’a
pas été jusque là envisagée de façon globale
et assez progressiste…
J’aimerai maintenant retourner la question et proposer quelques éléments
pour réfléchir à la façon dont la ville accueille
les formes artistiques, où pour le dire autrement quelle place l’art
peut-il y trouver ?
1
– Comment l’art en arrive à être public ?
Pour parler de l’art dans son rapport à la vie sociale et par
extension, à la ville, une première constatation est que, au
cours de l’histoire, l’art s’est immiscé dans les
villes surtout à partir de commandes « publiques », pour
honorer de hauts-faits, les personnages du pouvoir aristocratique et religieux,
ou les héros de la nation etc. La rue n’a pas autrement été
un terrain d’expression ou de diffusion de l’art de son temps,
jusqu’au XIX° siècle où, avec l’exemple notable
de Géricault et du Radeau de la Méduse (1819), l’œuvre
commente un événement d’actualité survenu deux
ans plus tôt. Et en partie du fait de cette proximité avec l’événement,
et un événement particulièrement horrible, elle est fustigée
par les juges des salons académiques. Géricault part en Angleterre
l’année suivante où l’œuvre devient un phénomène
d’attraction qui, pour rencontrer son public, a été montrée
sous un chapiteau itinérant de 1920 à 1921.
C’est
toujours au XIX° siècle que se sont inventés d’un
côté les musées, dans une volonté de culture et
une première approche scientifique de collection (les cabinets de curiosité),
et de l’autre les salons, où les artistes concourraient à
la fois pour la reconnaissance par leur pairs et pour accéder à
un marché de l’art naissant dans les milieux bourgeois. L’art
était enfin sorti des chapelles religieuses et des commandes princières
ou politiques. Il allait aussi bientôt sortir des académismes.
La révolution industrielle, qui comme bien des grandes articulations
historiques est souvent précédée de révolutions
artistiques, marque ainsi le passage vers une participation plus large de
l’art à la vie sociale, en tant que regard et critique de son
temps. Les grandes expositions qui marquent le passage du XIX au XX siècle
portaient aussi les arts contemporains (Raoul Dufy, la Fée Electricité,
1937) et il n’y a sans doute que les guerres qui aient fait reculer
le phénomène jusqu’ici.
Chaque
époque a vu différentes façons dont l’art pouvait
s’immiscer dans la réalité urbaine, hors ses lieux habituels
de monstration. Après la deuxième guerre mondiale, on peut citer
Nicolas Schöffer et sa sculpture robotique (CYSP, 1956) ou sa voiture-sculpture
en 1973, mais aussi Joseph Beuys (7000 Chênes), de nombreuses
formes issues du Land Art ou des actions plus provocatives politiquement avec
les performances de Chris Burden dès les années 70, ou Philippe
Meste, Gianni Motti en Europe récemment…
L’art semble trouver un terrain d’expression singulier dans la
rue, de sa propre initiative. Depuis, prenant acte de cette volonté
de confrontation à l’espace urbain, les autorités publiques
de nombreuses villes se sont mises à relayer le phénomène
avec des formes plus ou moins grandes de célébrations, de deux
manières très différentes :
- les territoires balisés que peuvent représenter les parcs
de sculpture en plein air (le Democracy Park à Busan / le jardin Tino
Rossi à Paris ou plus récemment les boulevards qui circulent
autour de la capitale.
- des événements temporaires ou permanents dans des espaces
non prévus pour l’art au départ :
A Paris : les champs de la sculpture, un événement festif «
la nuit blanche »… A Busan, des œuvres d’artistes internationaux
sur la plage depuis quelques mois, mais avant ça 4 expositions annuelles
à la Gare centrale de Busan à l’initiative de Lee Un-ho.
2
– L’art au cœur de la cité.
Lorsque le Centre Pompidou fut décidé, c’était
dans un principe humaniste de donner accès au plus grand nombre à
la culture et aux artistes du temps présent. Presque 30 ans plus tard,
cette institution, comme beaucoup d’autres, doit s’autofinancer
et fait payer (cher) ses entrées aux expositions, tout comme le droit
de visite des terrasses panoramiques, à des milliers de visiteurs par
jour.
Au même moment, dans les confins de Paris – on est même
passé de l’autre côté de la frontière, en
banlieue –, à Aubervilliers l’artiste Thomas Hirschhorn
emprunte quelques œuvres majeures et irremplaçables de la collection
du centre Pompidou (Malevitch, Duchamp, Dali, Beuys…), pour les exposer
dans un terrain vague. Un terrain vague au pied des barres d’immeubles
d’un quartier populaire, dont il a convaincu une partie de habitants
de participer à une expérience collective : monter et animer
un petit musée, jouer tous les rôles des métiers de l’exposition
et de la médiation, sans oublier l’architecture et la logistique
: le Musée précaire Albinet, ou quand l’art
va vraiment à la rencontre des autres. Cette initiative est commune
à l’artiste et à un lieu associatif indépendant,
les Laboratoires d’Aubervilliers. Il augure de nouvelles pratique d’accompagnement
de la création, entreprises sur la durée (un travail de plus
d’une année) et tournée vers un territoire et ses particularités,
ses possibilités, ses habitants.
L’exemple proposé par Hirshhorn n’est pas sans soulever des questions esthétiques fondamentales (exposer le travail des autres, mener un travail social plutôt que plastique), mais il importe surtout dans la mesure où il propose une « coréalisation » de l’œuvre par son public. Implication totale, complexe et versatile, d’individus qui ne s’étaient jamais autrement proposé de s’y intéresser.
L’art dans l’espace public, c’est ça : prendre le
risque de s’adresser à une majorité qui n’a rien
demandé, devoir dialoguer pour répondre aux interrogations ou
aux critiques…
L’espace public est une notion politique assez récente, qui ne
se comprend qu’à l’intérieur d’un contexte
démocratique. Le philosophe allemand Jürgen Habermas définit
l’espace public en 1962 : « L’espace public, c’est
un ensemble de personnes privées rassemblées pour discuter des
questions d’intérêt commun. Cette idée prend naissance
dans l’Europe moderne, dans la constitution des espaces publics bourgeois
qui interviennent comme contrepoids des pouvoirs absolutistes ; Ces espaces
ont pour but de médiatiser la société et l’Etat,
en tenant l’Etat responsable devant la société…
»
Il s’agit donc d’un espace physique (la rue, la place publique…)
autant que symbolique. Dans les deux cas, des différences culturelles
influent sur sa forme ou sur la façon dont on le pratique.
Pour revenir à la problématique de Power Tower, on peut aussi
se demander si les grandes infrastructures de vie, de loisirs et du commerce
que représentent les tours ne vont pas à terme faire reculer
l’espace public, puisque les tours appartiennent évidemment au
registre de l’espace privé et nous obligent à adhérer
à leur règlement intérieur.
Dans cette volonté de s’adresser à tous, l’artiste
devrait donc figurer parmi les premiers à se saisir de l’espace
commun. Pourtant, par soucis de régulation, les autorités limitent
les possibilités d’expression à leur autorisation expresse,
au bénéfice en premier lieu des annonceurs publicitaires. En
conséquence, l’espace public est d’ores et déjà
un espace « culturel » - images fixes ou animées, textes…
à la symbolique souvent forte pour frapper l’imaginaire des passants
(entre 2000 et 3000 impacts publicitaire par jour, pour un urbain). Il en
résulte que l’environnement urbain se compose d’un assemblage
fantastiquement complexe et animé, et on pourrait craindre que les
œuvres ne puissent rivaliser avec la publicité extérieure,
les enseignes lumineuses, le bruit de la circulation et la foule…
L’art, dans ce contexte difficile, peut représenter différentes
volontés :
- passer à une échelle supérieure que ne peut contenir
l’espace d’exposition
- rechercher une confrontation ou une participation maximale du public
- se fonder sur l’existant comme un matériau plastique, qu’il
soit architectural, sociétal, humain…
3
– Les lieux de l’art
Interrogeons-nous maintenant sur les lieux dans lesquels les œuvres s’inventent
et se réalisent
Si on revient sur la rapide introduction historique, on doit rapporter les
lieux de l’art à ceux incarnant un certain pouvoir, celui des
nations qui en ont décidé la promotion publique et la conservation
: les musées, grand palais patrimoniaux appartiennent inévitablement
au cœur historique des villes, et forment le centre des circuits touristiques.
Dans les mutations urbaines actuelles, force est de constater que les pratiques
artistiques ne peuvent plus prétendre à la même centralité.
Spéculation immobilière, gentrification des centres
urbains, cherté des loyers, les artistes doivent se mettre toujours
un peu plus à la marge de la ville pour trouver les espaces d’expérimentation
assez vastes et assez peu précieux pour leurs travaux.
Dans le même temps, la plupart des mégalopoles abandonnent leurs
périphéries industrielles – le reste du monde formant
une nouvelle « banlieue » riche en main d’œuvre –
pour n’y garder que les centres décisionnels, les sièges
sociaux. La banlieue mute, alternant zone d’habitation, très
grandes surfaces commerciales et sièges sociaux d’entreprises.
Face à cette raréfaction de l’offre d’atelier d’un
côté et à l’abandon de sites industriels de l’autre,
on assiste en Europe, depuis les années 80, à un phénomène
qui n’a été véritablement relevé par les
instances politiques qu’au tournant des années 2000. De nouveaux
centres voient le jour, fondés sur des lieux urbains « délaissés
» (Patrick Bouchain). On peut les appeler « lieux intermédiaires
», notion exogène qui hésite entre deux définitions
: le « squat » et le centre d’art (appellation réservée
en France à des lieux représentatifs des politiques culturelles
publiques). On peut les appeler plus poétiquement « nouveaux
territoires de l’art ». Au final, on ne peut que constater le
développement d’une variété d’initiatives
et de formes : la friche la Belle de Mai à Marseille ; le Confort Moderne
à Poitiers ; l’Hôpital Ephémère à
Paris ; Mains d’Œuvres… la Cable Factory à Helsinki,
le Melkweeg (fabrique de lait) à Amsterdam, etc. Le site internet www.artfactories.net,
hébergé à Mains d’Œuvres, en dresse un inventaire
partiel et en constante évolution.
Les banlieues industrielles se voient en partie reconverties, de façon
encore infime, en lieu de production d’imaginaire, d’esthétique
et de convivialité. Leurs modes d’organisation varient, mais
témoignent toujours de ce que ces associations d’individus concernés
recherchent de nouvelles façons d’accompagner les artistes de
leur temps et de partager à leur manière les créations
avec les publics, bien loin des squats, du moins si on en reste à la
définition du squat comme lieux libertaire rétif à toute
forme d’organisation. Ces nouveaux lieux représentent en particulier
un maillon dans la chaîne de production artistique, relativement délaissé
par les politiques culturelles publiques. Entre la formation artistique (école
d’art) et la diffusion des artistes une fois repérés (centre
d’art, galeries, musées…), il s’agit de concevoir
des lieux de pratiques, favorables à la création « en
train de se faire », à la confrontation avec d’autres artistes
et avec les publics, à l’expérimentation… De plus,
les pratiques artistiques actuelles supposent souvent un travail sur projet,
parfois en équipe ou avec des collaborateurs ponctuels (formes multidisciplinaires,
arts numériques, par exemple), et doivent de ce fait trouver des lieux
disponibles à des formes de maquettage, à la recherche de solution
à des problèmes techniques, logistiques ou financiers auxquels
l’artiste individuel ne peut répondre seul.
L’émergence de lieux indépendants de pratique et d’accompagnement
artistique se vérifie maintenant à de très différents
endroits de la planète : en Afrique, en Amérique du Sud, en
Asie… dans de nombreuses régions où les politiques culturelles
ne se consacrent pas, ou trop peu, à leurs artistes en développement.
Or ceux-ci s’organisent, rencontrent de nouveaux médiateurs et
génèrent de nouvelles scènes vivantes, expérimentales,
éphémères ou durables.
C’est un phénomène de réappropriation de l’action
culturelle par la société civile, plutôt que par les autorités
publiques ou, disons, en complémentarité. En conséquence,
nous pouvons observer que ces nouveaux espaces publics exercent pleinement
un droit de réponse, dans l’esprit de ce qu’Habermas a
proposé, aux institutions, aux politiques et aux élus à
qui les peuples ont confié le pouvoir.
Mathieu Marguerin_le 14 juillet 2007
+ + +
Exposition collective
Date d'exposition : 02.10.2009 - 14.10. 2009
Vernissage : Vendredi 02.10.2009, 18h-22h
Horaires d'ouverture de la galerie :
Lunidi, Mardi et Jeudi de 12h à 19h
Nocturnes Le Mercredi et Vendredi de 12h à 21h
Lieu :
Galerie Michel Journiac
47, rue des Bergers
75015 Paris
Frances
RER C Javel ou Métro 8 Lourmel
Artistes :
Argentinelee
Nadia Ben Amor
Isabelle Boitel
Isabel Cunha de Almeida
Edith Magnan
Christelle Mas
Yanghoun No
Edouard Rolland
Tél. +33 1 44 07 84 40
Je ne trouve pas le texte global qui représente cette exposition. Quelqu'un a ça? Qque je mis ici? L’exposition Power Tower, Paris-Busan réunit 14 artistes français
et 12 artistes coréens dans un dialogue artistique et culturel autour
d’un sujet commun : la tour.
L’image mentale que suscite une métropole, aussi bien pour le
touriste que pour l’habitant, est généralement dominée
par un monument évident, planté sur la ligne d’horizon.
La tour Eiffel à Paris et la tour de Busan ont en commun d’exister
d’abord en tant que dispositif technique – une antenne pour émettre
la télévision – qui est ensuite resté comme symbole
absolu de la ville. Au-delà du cliché touristique, le thème
de la tour renvoie à un phénomène mondial en explosion,
la poussée urbaine verticale, qui nous interroge quant à ses
fondements idéologiques, technologiques et sociétaux.
« Power Tower » : la tour incarnant le pouvoir ou bien la tour
délivrant une énergie, ou simples idoles super-héroïques
devenues architecture? De métropole en mégalopole, les gratte-ciels
semblent eux-mêmes des sculptures en exposition.
Avec Power Tower, Paris-Busan, les artistes nous proposent d’adopter
l’échelle des géants dominant le paysage ou de zoomer
sur des architectures minuscules, ils nous offrent un voyage dans les nouvelles
dimensions de la ville et des interrogations sur la symbolique de la tour.
Car après le modernisme du XXème siècle et le post-modernisme
fonctionnel et international, quel est l’avenir de l’habitat humain,
à l’heure des réseaux, de l’interconnexion et d’une
nécessaire écologie?
+ infos
_
Appareil - Vision (à venir)
_
Exposition collective
Date d'exposition :
17.09.2010 - 30.09.2010
Vernissage au Vendredi 17.09.2010, 18h-22h
Horaires d'ouverture de la galerie :
Lunidi au Vendredi de 12h à 18h
Lieu :
Galerie Michel Journiac
47, rue des Bergers
75015 Paris
France
Tél. +33 1 44 07 84 40
RER C Javel ou M.8 Lourmel
Artistes :
Argentinelee
Nadia Ben Amor
Isabelle Boitel
Isabel Cunha de Almeida
Nikoleta Kerinska
Yanghoun No
Cheng-Yu Pan
Texte du critique d'art :
A remplir un texte du critique d'art.
_
Argentinelee, Swing Machine,
Dispositif multimédia, 1,5x3x1 m, Paris,
2007.

Swing Machine (Machine de Balançoire) est une installation d’une vidéo projetée sur une balançoire suspendue. Les images projetées sont d’abord une reconstitution d'images clichées de villes métropolitaines comme Paris et Séoul, trouvé ou capturé grâce au moteur de recherche Google. L’artiste les a traitées avec des effets spéciaux de la technique virtuelle actuelle. Il en résulte de ses mouvements d’aller-retour, un circuit répétitif d'images virtuelles sur un mur qui s'effectuent de bas en haut ou du haut vers le bas.
Les moteurs de recherche actuels classifient les images selon leur système automatique, les images sur Internet sont de plus en plus considérées comme une information confirmée.
Dans cette œuvre Swing Machine, les images téléchargées ou découvertes sur Internet sont envisagées comme une vision aux systèmes informatiques, il s’agit d’une vision d’appareil de classification et d’indexation. Le véritable message du virtuel n’est pas l’information, mais plutôt une transmutation des messages de l’image virtuelle : comme le suggère Paul Virilio c'est l’interactivité, l’immédiateté et l’ubiquité.
Cette œuvre est une interprétation métaphorique qui résulte du percept paradoxal se situant entre le réel et le virtuel à travers la vision de la machine d’information.
_
Nadia Ben Amor, Espace immersif, Installation, Dimension variable, Paris,
2008.

Sa pratique débuta par des dessins qui mettent en œuvre des graphismes sinueux répondant avec immédiateté à des impulsions spontanées et, pour ainsi dire, non contrôlées, de la main qui les trace. Dans ces graphismes s’amorcent des figurations incertaines, fugaces, ambiguës comme le montre les figures ci-dessous liant ainsi intimement le transitoire et le permanent. Il en résulte une prise de conscience du caractère illusoire du monde que nous croyons réel, auquel nous donnons le nom de monde réel. Ces graphismes aux références constamment ambiguës ont la vertu de s’interroger sur le bien-fondé de ce que nous avons coutume de regarder comme réalité. Par la suite, l'artiste a trouvé nécessaire de donner plus de vie à ses dessins, et il en a découlé des images qui prennent des formes architecturales. Il lui ait venue ainsi l'envie d'abandonner les petits formats A4 et A3 et de recourir à des supports librement épanouis dans l'espace. Elle a été saisie par la suite par le désir de ne plus seulement faire face aux dessins, mais entrer dans l’image, de l’habiter. Le résultat obtenu correspond à des sortes d'architectures allusives et figuratives, des architectures ou plutôt des images constituées en un habitat.
_
Isabelle Boitel, Swimming-pool, Photos retouchées, Vitry,
2010.

Les photos qu'elle vous présente sont extraites de la série Swimming-pool. Par le biais de ses images, elle propose différent point de vue de la même photo. L'idée est de jouer avec le corps et son cadrage. Elle cherche à provoquer des situations qui établiraient une narration, d'abord grâce à ce corps plus ou moins présent dans l'image, et plus ou moins éloigné grâce au cadrage choisit. Mais pas seulement, en second lieu, elle voudra établir l'évidence du mouvement qui serait à l'origine d'une fiction possible. Le mouvement est incontournable par l'action du corps et de ce qui l'entoure (ici les vagues produites par le corps). Mais une seule photographie lui semble inappropriée pour émettre l'idée d'une fiction possible. Elle a donc recours à la série pour que l'action et le mouvement paraissent indubitables.
_
Isabel Cunha de Almeida, Fantômes, fantasme ou double ?, Photographie numérique, 30x45 cm chacun, lieu,
2010.
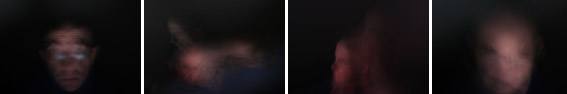
"A travers ce travail, je revendique l’esprit de mon personnage Z-héros disparu en 2006. Dans ce jeu, Z (mon modèle) devient un « appareil », le médium de ma
hantise." _ Isabelle Cunha de Almeida.
_
Nikoleta Kerinska, Titre de son oeuvre,
Genre, format, lieu,
année.

Corporal Sensation Specialist est une machine virtuelle mise en ligne pour fouiller l'intimité humaine. Dans un dialogue guidé, elle nous incite à mettre en forme verbale nos sentiments et sensations. Sommes-nous capables de nous dévoiler devant-elle? Elle demande : qu'est-ce le corps ? que se passe-t-il dans un rêve ? comment se présente une sensation ? Bref, pourriez-vous dire qui vous êtes?
http://sc.artificialis.com
_
Yanghoun No, Portrait,
Installation Multimédia, Dimension variée,
2010.

Portrait est une installation interactive. Le spectateur qui s’approche du cadre blanc voit son portrait déformé et la lumière sous la forme ronde s’allume derrière le spectateur grâce à un capteur de mouvement ; autrement dit, le spectateur est introduit dans une scène fictive à l'aide des appareils et c’est un passage du réel au virtuel. Il est possible d’interpréter la notion d'« appareil-vision » sous l'angle de l’écrasement, de la déformation et de l’enfermement visuel dans un monde fictif que je représente dans une salle semi-obscure. Les appareils mis en place nous procurent l'illusion d'un sentiment fictif et nous conduisent, enfin, à décliner d'une vision fictive, inscrites dans « l’appareil-vision ».
_
Chen-Yu Pan, eyeTunnel,
Vidéo, couleur, 3"30',
2010.

Dans cette vidéo, ce sont des portraits de mes amis qui se défilent en boucle, au travers de leurs pupilles. Il s'agit des images zoomées sur le visage de chacun(e). On trouvera peu à peu, en s'approchant sur l'œil du personnage, un reflet d'image d'un(e) autre ami(e) sur sa pupille. Sans arrêt du zooming, ce "reflet", qui est en effet un autre portrait, comblera l'écran et remplacera le précédent. De même, en s'rapprochant sur les yeux de ce nouvel personnage, se trouvera sur sa pupille encore un autre reflet de portrait, ainsi un se forment un bouclage.
Il s'agit d'un enchaînement des regards de mes entourages à travers l'utilisation des appareils équipant d'un appareil-photo. Procurées par ces appareils, des images ainsi que nos idées circulent ensuite entre chacun via Internet, c'est cette connectivité qui nous relie à nouveau en des réseaux, étroitement, de façon digitale. L'échange entre l'image du soi et celle de l'autrui est instantanée. Des yeux à l'appareil à Internet, jusqu'à l'écran de l'utilisateur et enfin retournée aux yeux, s'est formée ainsi un réseau de contemplation.
_